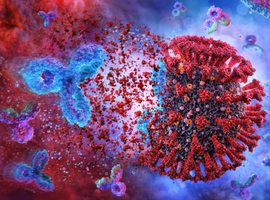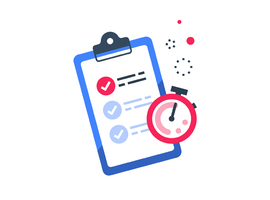Le docteur Bob Gérard a exercé la médecine générale en région namuroise de 1973 à 2018. Au fil des années, il a gardé des traces de sa pratique, de ses réflexions. Pendant le Covid, quand il a été considéré comme une personne à risque «pour son âge», il a pris le temps de tout coucher dans un livre. Dans «Passage de témoin» (1), il partage ces nombreuses années d’échanges avec ses collègues et ses patients. Il y aborde toutes les spécificités de la médecine générale, l’avenir de la médecine… et la retraite.
«Je suis sorti de l’université en 1973. J’ai toujours pris des notes au fur et à mesure de ma vie active. J’ai aussi, pendant une dizaine d’années, fait partie du comité de rédaction de La Revue de la Médecine Générale de la SSMG. Pendant le Covid, j’avais à peine 70 ans, je continuais à faire des prises de sang à la Clinique Saint-Luc de Bouge, mais à ce moment-là, je faisais partie des personnes à risque et je n’ai plus pu y aller pendant 2 mois. J’ai donc pris le temps d’écrire un livre.»
Le jeune retraité reste très actif. «Je continue à me rendre à l’hôpital tous les jours. J’y vais tous les matins de 9h à 11h comme médecin préleveur au laboratoire de biologie clinique. Comme je suis pensionné, je peux rester jusque 11h alors que la plupart des médecins généralistes préleveurs arrêtent à 9h pour se rendre dans leur patientèle. Cela me permet de garder un vrai contact. Je parle avec les patients, je réalise des tests fonctionnels…»
L’évolution du métier de médecin généraliste, il en parle au fil de dizaines de pages, mais il l’a surtout vécu. «J’ai été maître de stages pendant 20 ans. J’ai formé des dizaines d’assistants. Une chose a évolué, c’est la féminisation. Ma fille est urgentiste-interniste. À sa sortie en 2002, il y avait déjà 60% de filles. À présent, elles sont 70%.»
Sur le terrain, le métier évolue. «Les consœurs organisent, comme les jeunes médecins masculins, le métier autrement et donnent la priorité à la vie familiale. Cela a fortement modifié l’approche du médecin généraliste qui pouvait, dans les années 70, souvent travailler de 7h à 21h. En plus, on était de garde jour et nuit ce qui n’est plus le cas aujourd’hui.»
La garde, il en a connu l’évolution. «Je me souviens que dans les années 80, avec quatre médecins du coin, nous avions décidé de nous répartir les gardes dans la région.» Par la suite, les urgences des hôpitaux ont pris de plus en plus de place: «Jusqu’en 1990, les urgences étaient gérées par nous. Sauf les accidents de la route, les hémorragies ou les AVC que l’on accompagnait à l’hôpital. Il faut se rappeler que dans les hôpitaux, les premiers services d’urgence étaient gérés par les chirurgiens et les internistes.»
Le Dr Gérard estime que cette évolution de la médecine a un impact sur les patients. «Ils n’ont plus un médecin attitré. Les jeunes médecins se regroupent. Le patient, suivant les disponibilités, peut être soigné par un médecin ou un autre.»
Le renfort de la technique
Au fil des ans, le plus grand changement a, sans conteste, été celui des moyens techniques mis à la disposition des médecins: «En 1973, comme examens complémentaires, je disposais des radios pour les os, le thorax et les transits. À cela s’ajoutaient la prise de sang et la biologie. Parfois, on demandait l’avis d’un neurologue, d’un gastroentérologue ou d’un pneumologue… mais la majorité des problèmes étaient gérés par les généralistes.» Le monde médical a évidemment bien changé: «Dans mon livre, je reprends d’ailleurs les évolutions par spécialités. Cela m’a demandé un important travail de recherche. Par exemple, la cardiologie a connu une évolution importante, la pharmacologie aussi...»
Améloriation de la qualité de vie
Sa vie, sa famille justement, il en parle dans son livre: «Mon grand regret est de ne pas avoir été beaucoup présent pour mes 5 enfants. J’ai toujours tenu à conduire mes enfants à l’école le matin. Je prenais même d’autres enfants du quartier dans la voiture. Je terminais tous les soirs à 22h. Aujourd’hui j’ai 11 petits-enfants. De plus, de 1973 à 1996, sans GSM, mon épouse a été très présente pour le téléphone.»
Cette vie, les médecins actuels ne la connaissent pas. «Aujourd’hui, le travail se réalise en équipes des médecins. J’ai commencé à prendre des assistants avant l’an 2000 avec plusieurs collègues. Je n’ai jamais eu une très grosse clientèle parce que j’ai toujours voulu prendre le temps avec chaque patient. J’avais à cœur, lorsque j’avais réglé le problème pour lequel le patient me consultait, de consacrer du temps pour aborder un peu de préventif avec le patient, de parler entre autres des addictions, des dépistages, de la prévention globale pré-cancer... Je n’ai donc jamais fait plus de 3 à 4 patients à l’heure. On s’est donc partagé à deux ou à trois médecins un assistant. Progressivement, on s’est dit que l’on pourrait créer une maison médicale avec d’autres assistants. On a fondé Le Centre médical du Parc à Bouge près de l’hôpital en 2011. La maison médicale occupe des médecins, des assistants, des infirmières, des kinés, un psychologue… Notre qualité de vie s’est améliorée. J’y ai travaillé jusqu’en 2018.»
La retraite a été un choix réfléchi pour lui. «J’ai voulu arrêter à temps. Je ne voulais pas devenir un mauvais médecin. Avec l’âge, nous perdons tous la qualité de nos sens. J’ai eu l’occasion de remplacer des médecins qui avaient plus de 80 ans et qui n’entendaient pas bien ou qui prescrivaient des incompatibilités médicamenteuses. Nos 5 sens s’estompent avec l’âge: notre mémoire est moins bonne; nous écoutons moins bien le cœur ou les poumons… Aujourd’hui, je sais que je perds de l’ouïe.»
Enfin, la question du financement des soins de santé retient encore son attention. «Au début, quand je travaillais, la santé n’avait pas de prix. Aujourd’hui, on se rend compte qu’elle coûte cher.» Il a aussi pris le temps d’évoquer la loi sur les droits des patients: «J’ai eu l’occasion de beaucoup l’étudier.»
50 cas cliniques instructifs
Le Dr Gérard aborde une thématique importante: la question du doute. «Le médecin doit vivre avec le doute. Toute la vie, nous devons positivement douter. C’est un doute qui remet en question. La santé d’un patient peut évoluer dans le courant d’une même journée. Qu’est-ce qu’un médecin généraliste ne peut pas louper en présence d’une douleur abdominale? Une appendicite, une péritonite, une hernie étranglée… Avec l’examen, on exclut au fur et à mesure.»
Cet aspect de la pratique, et d’autres, il le développe dans le livre autour de 50 cas cliniques instructifs: «Les jeunes médecins ou les médecins assistants peuvent apprendre de ces cas… même si parfois les réponses technologiques doivent être adaptées.»
La question de la santé mentale n’y est pas éludée non plus: «Une chose a fondamentalement changé: quand j’ai commencé, nous avions des hôpitaux psychiatriques: 300 lits au Beau Vallon, 300 lits à Saint-Martin à Dave… rien que pour la province de Namur il y avait 900 lits. Un ministre de la Santé a décidé de supprimer 900 lits… on a donc dû hospitaliser les gens dans des hôpitaux ordinaires. Pour moi, la santé mentale était plus facile à gérer avant. Par ailleurs, on ne résout pas un problème de santé mentale avec seulement un médicament. Le généraliste doit prendre le temps d’écouter et utiliser au mieux la psychothérapie et les médicaments antidépresseurs ou antipsychotiques.»
Les avantages de l’informatisation
Le Dr Gérard a rapidement été séduit par la révolution offerte par l’informatique. «J'avais pris l’habitude pendant les stages en clinique de faire des dossiers médicaux par patient. Mes maitres de stage me l’imposaient. On faisait une page de garde avec tous les antécédents, les allergies, les vaccinations, le traitement en cours… À l’intérieur du dossier, on notait les rapports de visite ou consultations, les demandes d’examens, etc. Au début de ma pratique, je me suis rendu compte que la plupart de mes collègues ne faisaient pas nécessairement des dossiers. Ils retenaient tout de tête, disaient-ils, ou ils avaient un dossier par famille dans lequel ne figuraient que des résultats. Cela me paraissait étonnant d’autant plus que j’avais eu connaissance d’une étude, menée aux USA dans les années 80, qui concluait que des médecins généralistes ne mémorisaient en moyenne que 3 données par patient.»
Ces chiffres l’ont interpellé. «J’ai fait le calcul: les données minimales pour un dossier médical (antécédents familiaux, etc.) comptent au minimum 25 à 30 données de base par patient.»
À la lecture de sa réflexion, on comprend mieux qu’il ait tout de suite compris les atouts de l’informatisation. «En 1989, j’ai été un des premiers. J’ai eu la chance d’avoir un bon logiciel dès le début. A l’époque, le premier ordinateur, c’était le prix d’une petite voiture. J’ai vu des collègues, jusque dans les années 2010, travailler encore avec des dossiers papiers. Ils craignaient l’informatique. Ils avaient surtout peur de la transmissibilité et de la traçabilité des données. Ils n’avaient pas envie que l’Inami vienne scruter leur travail.»
Évidemment, cette machine dans le cabinet du médecin a amené une évolution de la relation avec le patient: «Je leur posais souvent la question pour avoir leur avis sur cette relation triangulaire. Les patients étaient contents que tout se trouve dans l’ordinateur pour le suivi de leur maladie.» Pour que toutes ces démarches ne lui prennent pas trop de temps, il pouvait compter sur une précieuse astuce par rapport à ses confrères: «Pendant les humanités, j’avais suivi des cours de dactylographie. Je tape des 10 doigts. On devrait rendre ces cours obligatoires dans le cursus des humanités pour faciliter la vie des médecins et d’autres professions.»